|
Anna THEODORIDES
En ce dimanche 18 avril 2021, nous avions invité Anna
Théodoridès à nous parler d’un de ses principaux sujets de
recherche, qui intéresse, au premier chef, pour des raisons
historiques, une large part de la Communauté hellénique de
Paris et, pour tout dire, à peu près tous les Grecs.
Pourvue de deux masters et d’un diplôme d’interprétariat,
notre invitée s’est attelée à la préparation d’un doctorat
en sociologie, à l’École de Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS) à Paris, sous la direction de Hamit
Bozarslan, sous un titre évocateur :
Survivre en contexte minoritaire : une étude sociologique
des résistances des Grecs d'Istanbul (Rûms polites) au
lendemain des émeutes de la nuit du 6 au 7 septembre 1955, à
Istanbul.
Un tel sujet portant à Istanbul (Πόλις) sur « la survie en
contexte minoritaire » impliquait de longues enquêtes auprès
des populations concernées à la suite d’un événement
tragique, c’est-à-dire une approche comparative des
constructions mémorielles des Rûms d’Istanbul, principale
cible du pogrom de la nuit du 6 au 7 septembre 1955, ce qui
a conduit notre chercheuse à résider successivement à
Istanbul, à Athènes et à Thessalonique.
C’est ce travail qui a nourri la conférence qu’elle a
présentée, en annonçant clairement la couleur :
Partir ou rester à Polis :
La survie des Grecs d’Istanbul au lendemain des violences de
la nuit du 6 au 7 septembre 1955.
Ces sinistres événements de septembre que nous appelons
communément Τα Σεπτεμβριανά, eux-mêmes alimentés par
l’épineuse question de fond chypriote (le sort de l’île se
jouant, au même moment, à Londres), furieux pillages
spoliations et massacres auraient été déclenchés par
l’attentat, jamais vraiment élucidé, de la maison natale de
Mustapha Kemal à Salonique. Leur déchaînement est surtout
une illustration supplémentaire d’une politique d’ingénierie
démographique qui porte un nom : la purification ethnique,
périodiquement mise en œuvre par la Turquie.
Au lendemain de ces émeutes et des catastrophes qui
s’ensuivirent, la population rum de Constantinople dut
affronter un dilemme pour le moins cornélien : rester ou
partir. Ceux qui choisirent de rester durent adopter des
stratégies et des comportements de survie en milieu
particulièrement hostile. C’est en s’appuyant sur de
minutieuses recherches ethnographiques que A. Th. nous
montre comment, au lendemain de cette nuit tragique, les
Grecs d’Istanbul se sont mobilisés, quels comportements
ont-ils dû adopter pour préserver leur unité, leur identité,
leur singularité, bref leur ancrage dans l’histoire
cosmopolite d’Istanbul.
Pour ceux qui ont
préféré partir, la chercheuse enquêtera aussi à Athènes et à
Salonique, principaux points de chute de ces exilés semi
volontaires. Mais ce volet fera l’objet d’une seconde
conférence dans un très proche avenir.
Anna Théodoridès
nous a exposé par le menu ses méthodes de travail et
d’investigation, la façon de mener ses interviews avec les
outils méthodologiques appropriés : ainsi la typologie des
tranches d’âge interrogées (adultes ou nouvelles
générations) mais aussi les groupes sociaux, tels que les
Eduqués ou Lettrés, d’une part, et les Silencieux, de
l’autre. Ses observations lui ont permis de mettre en
lumière des « astuces » servant à mettre en place une forme
de résistance, silencieuse et souterraine, qui ont élaboré
des stratégies de survie, comme d’accommodation, suivant des
logiques d’évitement et d’effacement, de contournement,
d’anticipation du danger et d’auto-contrôle.
Le sujet suscita un
vif intérêt et souleva un grand nombre de questions et de
remarques. Nous attendons impatiemment le second volet de
l’enquête de Anna Théodoridès et la remercions vivement
d’avoir partagé avec nous les tenants et les aboutissants de
ce travail passionnant.
M. R.
|
|
Τα Σεπτεμβριανά – Les événements de
septembre 1955 ont marqué la mémoire collective des Grecs d’Istanbul
: préparées de longue date par les services secrets turcs, ces actes
de violences anti-minoritaires ont éclaté principalement à Istanbul,
suite à des rumeurs de plastiquage de la maison natale d’Atatürk à
Thessalonique.
La presse de propagande, Istanbul Ekspres a diffusé
cette nouvelle à Istanbul alors que se jouait le sort de Chypre lors
de la conférence tripartite à Londres.
C’est ainsi qu’à
l’initiative des organismes de droite radicale et de l’association «
Chypre est turque » soutenue par le pouvoir, plus de 100.000
personnes ont participé aux saccages et destructions de plus de 6000
bâtiments.
Ces émeutes ont
ciblé principalement les membres de la communauté rûm.
Des églises
orthodoxes ont été vandalisées avant de brûler, deux cimetières
profanés, les commerces saccagés et pillés.
Plus d’une soixantaine
de femmes ont été violées, quelques popes orthodoxes circoncis.
Bilan : 11 morts.
Ce travail est le fruit de ma thèse de doctorat soutenue à l’Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Je vous propose deux conférences :
La première s’appuie sur l’enquête menée à Istanbul. Elle se
concentre sur les membres de la communauté qui résident toujours à
Istanbul : ils mènent depuis 1955, une forme de résistance,
silencieuse et souterraine en élaborant des stratégies de survie.
La seconde conférence vous sera proposée à une date à définir.
|
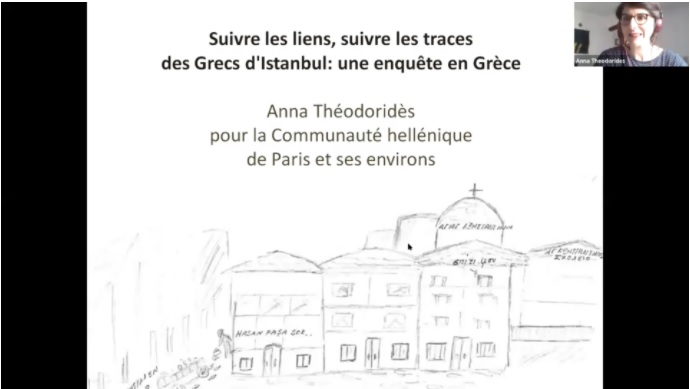 |
|
|
Le 30 mai 2021, Anna
Théodoridès a bien voulu évoquer pour
nous le second volet de son enquête portant sur
le sort d’une partie des Grecs d’Istanbul (Polites)
qui, eux, ont choisi de partir, discrètement, à
la suite des violents événements de la nuit du 6
au 7 septembre 1955 –connus sous le nom de Τα
Σεπτεμβριανά. Et qui ont cherché des moyens de
survie dans un pays d’accueil, principalement en
Grèce, tout comme leurs concitoyens l’avaient
fait en restant à Polis.
Cette fois-ci, l’enquête a été menée par A. Th.
en Grèce, essentiellement à Athènes et à
Thessalonique. Les recherches ont été effectuées
d’après des listes d’exilés « volontaires » qui,
entre 1955 et 1963, sont majoritairement mariés
et pères de famille ; il y a, néanmoins, des
listes d’unités générationnelles différentes,
avec des niveaux de vie différents (éducation,
maîtrise de la langue) des jeunes instruits, des
intrépides qui ont choisi d’affronter l’inconnu,
des familles nanties, des « éduqués » ou alors
des « silencieux », ceux qui rencontrent le plus
de problèmes de travail, de santé et de
scolarité pour leurs enfants et qui préfèrent
résister dans l’invisibilité.
Leur destin et leur destination dépendent
souvent des opportunités professionnelles qui se
présentent dans le pays d’accueil, de leur
nationalité (hellénique ou turque), des contacts
dont ils disposent parmi leurs amis ou les
membres de leur famille déjà installés en Grèce,
de la mobilisation face aux expulsions
collectives.
Quoi qu’on en pense, il leur a fallu faire face
à une certaine stigmatisation, (giaour en
Turquie, τουρκόσποροι en Grèce !) – même
migrants actifs pour les premiers expulsés, ils
étaient pour bon nombre d’entre eux des
réfugiés… en somme des SANS-repères !
En conclusion, on peut dire que, pour préserver
leur identité et se construire un espace
(social), les Grecs de Constantinople (Polis)
ont mené des combats voisins tant à Istanbul
qu’à Athènes ou à Thessalonique.
Merci infiniment à
Anna Théodoridès pour les deux conférences
qu’elle a offertes à la Communauté hellénique de
Paris et des environs.
Marie Roblin
|
|
|



